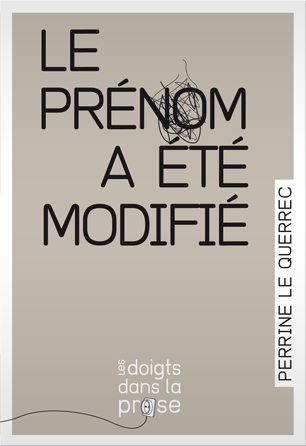BLOG
Chronique d’André Markowicz
(Facebook, 25 mai 2014)
 David Marsac, l’éditeur des « Doigts dans la prose » qui a retrouvé et publié ma traduction des « Vingt sonnets à Marie Stuart », habite au Mans. Il m’avait proposé de faire une lecture au Mans. Si je venais au Mans, c’était, évidemment, à la Fonderie — un lieu que je fréquente depuis plus de vingt ans. Le lieu, c’est une chose, mais — les gens : François Tanguy et Lauren…ce Chable, et tous les autres… Je pense qu’on peut le dire comme ça : je suis un compagnon de route du Radeau, depuis que je les ai rencontrés grâce à Emmanuel de Véricourt, au TNB. Un théâtre qui naissait sans paroles, sans images — ou plutôt où les images naissaient, justement, comme d’être sans récit — j’avais été très très touché par le spectacle que j’avais vu, — qui n’était pas un spectacle, mais une mise en présence musicale, rythmique, charnelle, de quelque chose qui se sentait de fragment en fragment, dans une espèce de lenteur que j’avais ressentie comme un écho de Mandelstam, « Sœurs — pesanteur et tendresse — vos signes sont semblables »… En sortant, j’avais dit à François, je me souviens, en plaisantant, puisqu’il n’utilisait aucune langue : « jamais on ne travaillera ensemble… » et voilà… — Ce n’est pas seulement que nous avons travaillé ensemble, et très souvent, par exemple sur « Onzième », autour de Dostoïevski. Et ce n’est pas seulement que les textes que j’écris sont construits sur la juxtaposition d’ombres de citations, d’ombres d’images, sur un lien métrique — parfois rigide (comme pour les sonnets), parfois plus souple (pour tous les textes non rimés) — construits, un peu, je crois, comme les spectacles du Radeau… enfin, disons que je suis souvent dans ces spectacles quand j’écris. C’est que nous sommes amis.
David Marsac, l’éditeur des « Doigts dans la prose » qui a retrouvé et publié ma traduction des « Vingt sonnets à Marie Stuart », habite au Mans. Il m’avait proposé de faire une lecture au Mans. Si je venais au Mans, c’était, évidemment, à la Fonderie — un lieu que je fréquente depuis plus de vingt ans. Le lieu, c’est une chose, mais — les gens : François Tanguy et Lauren…ce Chable, et tous les autres… Je pense qu’on peut le dire comme ça : je suis un compagnon de route du Radeau, depuis que je les ai rencontrés grâce à Emmanuel de Véricourt, au TNB. Un théâtre qui naissait sans paroles, sans images — ou plutôt où les images naissaient, justement, comme d’être sans récit — j’avais été très très touché par le spectacle que j’avais vu, — qui n’était pas un spectacle, mais une mise en présence musicale, rythmique, charnelle, de quelque chose qui se sentait de fragment en fragment, dans une espèce de lenteur que j’avais ressentie comme un écho de Mandelstam, « Sœurs — pesanteur et tendresse — vos signes sont semblables »… En sortant, j’avais dit à François, je me souviens, en plaisantant, puisqu’il n’utilisait aucune langue : « jamais on ne travaillera ensemble… » et voilà… — Ce n’est pas seulement que nous avons travaillé ensemble, et très souvent, par exemple sur « Onzième », autour de Dostoïevski. Et ce n’est pas seulement que les textes que j’écris sont construits sur la juxtaposition d’ombres de citations, d’ombres d’images, sur un lien métrique — parfois rigide (comme pour les sonnets), parfois plus souple (pour tous les textes non rimés) — construits, un peu, je crois, comme les spectacles du Radeau… enfin, disons que je suis souvent dans ces spectacles quand j’écris. C’est que nous sommes amis.
*
 Bref, je voulais que cette rencontre au Mans se passe là, à la Fonderie, chez François et
Bref, je voulais que cette rencontre au Mans se passe là, à la Fonderie, chez François et
Laurence.
La rencontre avait été fixée au 24 mai. J’étais libre le 24, j’avais dit oui.
J’ai vu qu’on m’avait préparé une table, et disposé des livres sur la table : pas seulement les « Sonnets », mais aussi « Le Soleil d’Alexandre », et aussi mes « Figures »… Et, je ne sais pas, moi qui parle très rarement assis quand je fais des rencontres publiques, je me suis senti très très bien, assis. Le ton devait donc être celui, non pas d’une conversation (ce que je fais d’habitude), mais autre chose… et l’idée m’est venue de lire, tout simplement, le texte entier, en russe et en français. De faire entendre les deux langues — avec des commentaires, bien sûr, mais, en voyant le regard des gens qui étaient venus là, surtout ça, faire entendre les voix du texte. Et quand j’ai eu fini, et que nous étions comme encore emplis de cette tristesse à la fois sarcastique et douce qui en émane, d’un coup, j’ai fait attention à la date. Le 24 mai, c’était l’anniversaire de Joseph Brodsky.
Alors, nous avons levé nos verres à sa mémoire. À sa présence parmi nous. Avec, je crois, une gratitude commune.
Brodsky est le poète de la gratitude — c’est ce mot, je crois, qui le caractérise le mieux. La solitude, le désespoir, la rage, des accents qu’on pourrait croire cyniques, et, à la fin des fins, une lumière éclatante, « Dans la nuit la plus noire, quelle lumière/quand l’obscurité et l’encre se fondent ! » (Elégies romaines, 8).
Je voulais republier ici un autre — long — poème que j’ai traduit (publié dans le recueil « Vertumne », chez Gallimard). Un poème de Pâques. Sur l’exil, le nord, le froid, la vieillesse qui vient — et la lumière.
J’ai au nord de la terre trouvé abri,
vent de la terre où, s’arrachant au rocher, l’oiseau
voit son reflet sur le dos du poisson et s’écrie
« merde ! » en brisant le miroir amalgamé des eaux.
Nul ici ne se sauve, même enfermé à clé.
Dedans — débâcle. Dehors, pas plus encourageant.
Vitre dès l’aube engloutie de nuages bâclés.
Rares terres, plus rares gens.
L’eau dans ces latitudes règne car quel crétin
irait montrer du doigt l’espace et lui crierait : « Pars ! » ?
L’horizon se retourne comme un manteau déteint
par l’âge — ou les rouleaux qui grisent de part en part.
Nul ne distingue ici l’être et sa liquette accro-
chée au clou sur la veste évoquant un suicidé
dans la pénombre. La main cherche ledit cros,
trouve, palpe, s’arrache — « Christ est ressuscité ».
2.
J’ai au nord de la terre trouvé abri
entre la brique et « brr » à cause de l’aquilon,
terre où, quand on forge les vagues, leur forgerie
les doue de crinière mais, ne brillant jamais long-
temps, elles sont à l’image du cerveau qui perd
la perle aperçue sous les frises permanentées.
L’être qui les mit en branle a commis l’impair
de ne pas leur apprendre à se voir se démonter.
Ici le rictus paraît devant tes flots houleux
de discours sur tes propres traits, sur les rocs pantois
car le ressac est plus obligatoire que le
basalte, que l’homme accroché au rocher, que toi, —
or le souffle froid renfouira dans la gueule du
chien l’aboiement et, bien sûr, tes grasseyeux accents.
Pour voler quelque chose quand l’écho s’est perdu
il faut le multiplier par cent.
3.
J’ai au vent de la terre trouvé abri.
Moi, comme un caillot incrusté, lui — mon bouclier.
ici quand on viendra me prendre je serai pris,
la chair est trop ridable pour se faire oublier.
Dans ces espaces couleur de levure gris-vert,
débarrassant la carte du bric-à-brac
frontalier, nappe sous une forêt de couverts
cliquetants, elle s’étale et elle émet un « crac ».
Et, invité unique de ce banquet sans fin,
c’est avec chaleur que je lui renverrai l’écho
car j’aurai pu, quoi qu’on dise, rassasier ma faim
et pas uniquement grâce aux haricots.
Les vivants et les morts se comptent par la longueur.
Mais si loin que Borée te raplatira son drap
sur le nez, dans le grand déballage, face au chœur
froid, nul sur la terre venteuse ne te vendra.
4.
J’ai au nord de la terre imbriqué mes mots !
L’âme qui prend le temps pourra tel un perroquet
répondre au tout malgré l’ininterruption des mau-
vais lieux d’éternité maritime ou les hoquets.
Là, dépeçant sa pièce, le tisserant fait : « Bon ! »
À peine brûlé le fil, l’aiguille a disparu.
Ajoutez les blocs déserts comme une gare dont
les rails sont rouillés par l’herbe des rues.
J’ai au vent de la terre trouvé abri.
Nul ne me prend à partie : « Tu n’es pas de chez nous
là, retourne d’où tu viens ! » et fait payer le prix
de l’hôtel : la peau grivelée, des clous.
La lanterne du môle fait cligner, crépiter
son verre, un moine, un flic chaussé de fer-blanc.
La grandiose écriture court se précipiter
à la casse, illisible dans ce fracas troublant.
5.
Tourne-toi vers le mur, chuchote : « Je dors, je dors. »
La couverture est grise, tu es vieux.
j’aurai tant rêvé cette nuit, c’est un vrai stock d’or
que j’offrirai à la mer qui me criera : « Mes yeux ! »
T’envoyer te faire ou recevoir l’envoi — pareil.
Le ronflement rattrapera toujours le ronfleur.
Emmêlé dans les dessous, vasouillant au réveil,
tu rampes, crabe. Les fonds de la mer ont le leur.
C’est ce que chantonnait, cachant ses branchies, un lo-
cataire du ciel plus pâle qu’un péché conçu
la nuit, se lavant les yeux sous la rage de l’eau
sablée où l’arête et la chair lui créaient Jésus.
Ainsi s’accroche la pince — oui, justement là.
La nue a gardé la trace de qui l’a troué.
Le pied s’avance. Ainsi, le pied est posé à plat
sur la vague. Voici que je marche sans bouée.
(copyright Gallimard, 1993)
(Voilà ce qui s’appelle un livre bien fait pour vous.)
(On n’est jamais mieux sapé que par soi-même.)